Quelle drôle d’époque. Ou triste peut-être plutôt tant l’absence de rêves, de projections, d’idéaux nous hante. Peu de signaux positifs nous sont envoyés. La planète comme les avancées sociales se désagrègent peu à peu, un peu partout. On ne voit plus d’entreprises qui font envie. Elles sont soit engluées dans des procédures et des processus sans queues ni têtes sans aucun avenir si ce n’est le status quo. Soit avec des envies d’ultra-technologie déshumanisée : l’IA, les réseaux sociaux, et j’en passe. Le tout étant orchestré et compartimenté par la propagande et l’asservissement des grandes corporations de l’anti-web. On ne songe pas à faire. On ne songe qu’à produire pour amasser. Tout est devenu gris.
Quand j’essaye de limiter (vraiment très peu, trop peu) les parties de jeux vidéos de mon plus jeune fils lui disant qu’il ne vit pas dans le monde réel, il me rétorque, à presque 12 ans, “Gaza, l’Ukraine, Trump, laisse-moi dans mon monde de fiction”. Et il a peut-être bien raison. Je me soigne en me disant que j’ai vécu à l’époque de Robert Johnson, Led Zeppelin, et de l’invention de la guitare électrique.
Je cherche ce qui pourrait arriver de positif. Je cherche à trouver des pistes de renouveau. Et sans surprise ce renouvellement est proposé déjà depuis des années dans l’ancien. Comme toujours le plus difficile n’est pas de savoir ce qu’il faudrait faire, mais d’y arriver. De passer d’un point A à un point B. De se déplacer, de ne pas être figé par les phares de la voiture qui nous fonce dessus.
Qu’est-ce que je trouve dans l’ancien ? Je suis au début d’un nouveau parcours (de pensée). Il se nourrit de trois contenus actuellement.
Small is beautiful, les effets de seuil
Ici je parle de Léopold Khor, et son livre l’effondrement des puissances. Son idée est simple, mais puissante. Vous connaissez Léopold Khor ou en tout cas l’expression qu’il a inventé “small is beautiful”. À ses yeux tout vient d’un effet de seuil : à partir d’un certain point on est trop puissant, ou trop riche, ou trop quelque chose. On dépasse un seuil et soit on perd notre sens, ou plutôt les effets de bord deviennent plus important, plus impactant, que notre sens premier. Soit on est amené à déclencher des actions nocives, les guerres par exemple. Nocives pour l’humanité, pour le futur. En ce sens une petite guerre entre deux petits états n’est pas nocive (même si douloureuse) car limitée à deux petits états, qui rapidement cesseront de guerroyer. Rien à voir avec des guerres d’états omnipotents. Et vous pouvez reprendre cette idée de nocivité de la taille avec les entreprises, ou tout autre chose.
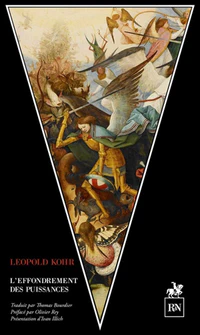
Et s’il suffisait de limiter la taille des choses pour éviter ces basculements ou ces effets de bord, pour éviter ces nocivités à grande échelle ? L’IA dans la médecine pour la détection des signaux faibles c’est merveilleux. L’IA partout c’est un cauchemar. Des entreprises qui nous proposent des services en ligne c’est utile. trois mégaentreprises qui gouvernent tous les services en ligne c’est un cauchemar (où est passée la loi américaine antitrust ?).
Mettre toute le monde d’accord dans un grand groupe pour prendre une décision, ou imposer la même décision à tous, c’est ahurissant. Laissez des petits groupes essayer des choses et observer pour prendre ce qui en sort de bien c’est utile.
Peut-on aujourd’hui accepter d’entendre qu’il faudrait limiter la taille de nos entreprises, que nos entreprises ne sont intéressantes qu’à une certaine taille ? Faut-il apprendre du régionalisme, du fédéralisme, des cités-États ?
Comment aujourd’hui scinder les grands ensembles (intelligemment ! Pas comme les entreprises qui sont découpées de façon totalement absurde pour éviter des questions anticoncurrentielles comme je le vois dans l’énergie ou les transports actuellement) pour retrouver une taille humaine (avec sa part d’humanité) ?
Qui aujourd’hui aurait ce courage ? Le courage de se scinder. Le courage de ne pas grossir.
Pas d’endoctrinement et d’uniformisation
Très lié à cela, il y a aussi Ivan Illich et ses pamphlets prophétiques, par exemple “Une société sans école”. Carrément, une société sans école, quand Illich décide de renverser la table là où cela fait le plus mal, la sacrosainte école. L’école c’est par essence le bien : on apprend, on éduque, on grandit, non ? À Illich de nous montrer justement que le système est devenu tellement centralisé, unique, il nous façonne tant que d’une part : il exclut avec beaucoup de douleurs ceux qui ne sont pas dans le système. Une fabrique de l’exclusion, ou de la notation : selon le niveau d’étude. Une classification, que l’on sait artificielle, de chacun.
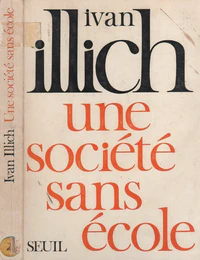 Et le système se détourne de son but : on ne cherche plus à apprendre, on cherche à réussir son cursus scolaire, rien à voir. Réussir son cursus scolaire ce n’est pas apprendre. Le système ostracise : c’est à l’école que l’on est censé apprendre, pas ailleurs, pas différemment.
Et le système se détourne de son but : on ne cherche plus à apprendre, on cherche à réussir son cursus scolaire, rien à voir. Réussir son cursus scolaire ce n’est pas apprendre. Le système ostracise : c’est à l’école que l’on est censé apprendre, pas ailleurs, pas différemment.
L’école ou autre, son propos est l’endoctrinement, l’uniformisation, et encore les effets de seuils qui détournent des objectifs originaux.
Les deux propos se rejoignent : pas de gigantisme, mais une multitude. Pas d’uniformisation, mais une multitude. Et le propos est politique : la main-d’œuvre est identique s’il n’y a pas de multitude, et donc plus simple à utiliser. Le consommateur est identique s’il n’y a pas de multitude, et donc plus simple à utiliser. Etc.
Est-il trop tard pour essayer de démembrer le gigantesque système planétaire qui tend vers une unicité. Non, il n’est pas trop tard. Mais cela passe par une reprise en main, chacun, chacune, de nos environnements et de nos choix. Une reprise en main de notre autonomie.
Autonomie et contrôle de son environnement
J’en arrive à mon troisième point, Jacques Ellul, et son livre “Le système technicien”. Ils s’entremêlent et s’influencent tous : Khor, Illich, Ellul. Il y a uniformisation, endoctrinement, asservissement quand il y a perte d’autonomie, quand il y a une perte de contrôle de son environnement. Et lié à cela, aussi une perte d’engagement, d’envie, perte de sens.
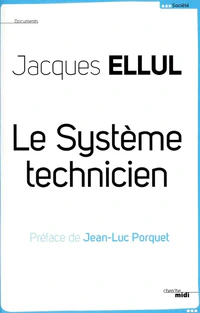
Pourquoi chaque choix que nous faisons aujourd’hui vis-à-vis de la technologie est excité par la prouesse réalisée et pas par l’impact sur nos vies ? Je paraphrase, mais c’est la question qui se pose. C’était le rôle des traditions. Il y a plein de choses négatives dans le mot tradition. Mais il y avait l’idée de mesurer l’impact sur nos vies de chaque nouveau choix qui s’imposait, du rythme à donner aux choses, de la taille à donner aux choses.
Cette vidéo de Jacques Ellul illustre bien mieux le propos que les mots que je pourrais écrire : https://www.youtube.com/watch?v=01H5-s0bS-I
Aujourd’hui il s’agit d’avoir le courage de refuser le gigantisme, l’uniformisation (et peut-être le centralisme), la systématisation, le mécanique qui ne servent et ne facilitent les choses que pour ceux qui veulent diriger le monde. Ce qui nous sert à nous c’est l’autonomie, la capacité à changer les choses, être responsable, avoir du sens (et probablement de la proximité).
Interrogez-vous sur ce qui vous fait perdre cette autonomie, cette responsabilisation, cette capacité d’action et combattez-le !